Note :
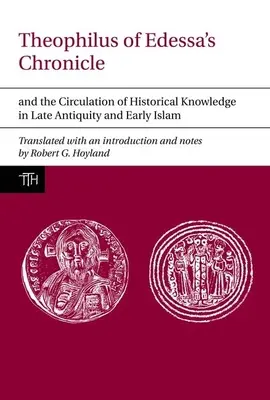
L'ouvrage explore le problème synoptique syriaque et vise à reconstruire la chronique perdue de Théophile grâce à une analyse comparative de diverses sources datant de 590 à 767 après J.-C. Il fournit des traductions précieuses et des informations sur les débuts de l'histoire islamique. Il fournit des traductions et des informations précieuses sur les débuts de l'histoire islamique, bien que son objectif principal, qui est d'identifier une « source syriaque commune » unique, soit discuté.
Avantages:Développe les travaux antérieurs, notamment en fournissant des traductions de textes importants qui n'étaient pas disponibles en anglais.
Inconvénients:Offre un portrait comparatif des événements historiques de la fin de l'Antiquité au début de la période islamique, ce qui le rend attrayant tant pour les chercheurs que pour les lecteurs en général.
(basé sur 4 avis de lecteurs)
Theophilus of Edessa's Chronicle and the Circulation of Historical Knowledge in Late Antiquity and Early Islam
Théophile d'Édesse était astrologue à la cour des califes musulmans entre les années 750 et 780, à une époque où leur capitale, Bagdad, était un centre cosmopolite florissant de culture et de commerce et l'une des villes les plus peuplées et les plus prospères du monde. Il parlait couramment le grec, le syriaque et l'arabe.
Il s'est servi de cette capacité pour rassembler un certain nombre de sources historiques dans chacune de ces langues et les fondre en une seule chronique qui retrace les événements survenus au Proche-Orient de 590 aux années 750. Son ouvrage n'existe plus, mais il a été abondamment cité par un certain nombre d'historiens ultérieurs.
Robert Hoyland a rassemblé et traduit toutes ces citations afin de donner une idée de la portée et du contenu du texte original. C'est important, car cette chronique est à la base d'une grande partie de nos connaissances historiques sur le Proche-Orient des VIIe et VIIIe siècles, qui a été une période cruciale.
Il s'agit d'une période cruciale dans la région, marquée par la guerre dévastatrice entre les deux superpuissances que sont Byzance et l'Iran, les conquêtes arabes et l'accession au pouvoir de la première dynastie arabe musulmane, les Omeyyades (660-750), puis leur renversement par une nouvelle dynastie, les Abbassides, qui déplacent la capitale du Proche-Orient à l'est de l'Iran.
L'empire musulman de Damas à Bagdad. Hoyland indique également les liens entre la chronique de Théophile et d'autres ouvrages historiques, rédigés par des musulmans et des chrétiens, afin d'illustrer le degré considérable d'échange d'idées et d'informations historiques entre les différentes communautés du Proche-Orient.
communautés du Proche-Orient.
Le matériel traduit consiste en des sections de quatre chroniqueurs qui traitent de la période 590-750 : un en grec (Théophane le Confesseur, mort en 818), un en arabe (Agapius de Manbij, vers les années 940) et deux en syriaque (Michel le Syrien, mort en 1199, et un auteur anonyme, vers les années 1230, qui étaient tous les deux des écrivains.
Il s'appuie sur la chronique de Dionysius de Telmahre, mort en 845). Les trois derniers n'avaient pas été traduits en anglais auparavant (donc Agapius et Michael the Syrian) ou ne l'avaient été que partiellement (le chroniqueur anonyme des années 1230).